Maurice Barrès, cent ans après
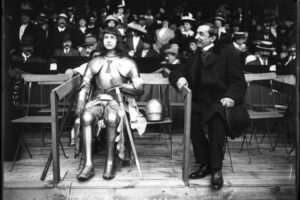
Voilà un siècle, presque jour pour jour, que Maurice Barrès s’est éteint. L’influence qui fut la sienne au sein de sa génération fut énorme, comme l’affirma Léon Blum :
« Si Monsieur Barrès n’eût pas vécu, s’il n’eût pas écrit, son temps serait autre et nous serions autres. Je ne vois pas en France d’homme vivant qui ait exercé, par la littérature, une action égale ou comparable. »
Si cette œuvre exerça une influence fondamentale au début du XXe siècle sur les idées de son temps, qu’en retenir aujourd’hui ? C’est précisément la question à laquelle nous tenterons de répondre ici, en tentant de cerner le fil directeur de ses idées politiques.
S’il est difficile de synthétiser l’œuvre de Maurice Barrès, il n’est pas impossible de cerner les grandes étapes de sa vie militante, et par là-même l’évolution de sa pensée et sa définition du nationalisme.
« Le nationalisme, c’est l’acceptation d’un déterminisme. » a-t-il déclaré. Ainsi, pour comprendre le nationalisme de Maurice Barrès, il nous faut saisir sa raison d’être, la nécessité fondamentale qui aboutit à intégrer consciemment un collectif, une communauté nationale. C’est ce qu’il nomme le déterminisme.
Maurice Barrès, « très marqué par la notion de décadence », comme l’indique l’historien Olivier Dard, a tenté d’expliquer à ses contemporains comment parvenir à s’émanciper d’une société bourgeoise jugée pernicieuse et amorale par nature. Parti du « culte du moi », le natif de Charmes débouche sur les romans de L’Énergie nationale. Barrès se cherche et finalement se trouve au tournant du XXe siècle.. Pourtant mi-auvergnat par son père, Barrès choisira de se considérer d’abord et avant tout comme un Lorrain. C’est dans l’ancien duché de l’est de la France qu’il s’est « raciné », selon sa propre formule. De la conscience individuelle à celle du collectif, il y a donc une chemin possible:
« Penser solitairement, c’est s’acheminer à penser solidairement. »
Comment parvenir à se « raciner », justement ? En acceptant un déterminisme. Autrement dit, accepter l’idée que nous sommes d’abord et avant tout un héritage, d’abord et avant tout le résultat de millénaires d’histoire ayant forgé notre psychologie, tant par la culture que par le sang, et donc que notre individualité personnelle est réduite. Nos ancêtres, ainsi, sont ce que nous sommes, et plus encore comme l’écrivit Barrès :
« Épouvanté de ma dépendance, impuissant à me créer, je voulus du moins contempler face à face les puissances qui me gouvernent. Je voulus vivre avec ces maîtres, et en leur rendant un culte réfléchi, participer pleinement de leur force. »
Ainsi, chacun n’est disposé à penser et ressentir qu’en fonction de son origine :
« Constatez que vous êtes faits pour sentir les Lorrains, en alsaciens, en bretons, en belges, en juifs. »
Barrès s’est ainsi lui-même émancipé des idées de ceux qui furent dans sa jeunesse ses guides :
« Tous les maîtres qui nous ont précédés et que j’ai tant aimés, et non seulement les Hugo, les Michelet, mais ceux qui font transition, les Taine, les Renan, croyaient à une raison indépendante existant dans chacun de nous et qui nous permet d’approcher la vérité. Voilà une notion à laquelle pour ma part je me suis attaché passionnément. L’individu ! son intelligence, sa faculté, de saisir les lois de l’univers ! Il faut encore abattre. Nous ne sommes pas les maîtres des pensées qui sont en nous. Elles ne viennent pas de notre intelligence; elles sont des façons de réagir où se traduisent de très anciennes dispositions physiologiques. Selon le milieu où nous sommes plongés, nous élaborons des jugements et des raisonnements. La raison humaine est enchaînée de telle sorte que nous repassons tous dans les pas de nos prédécesseurs. Il n’y a pas d’idées personnelles; les idées même les plus rares, les jugements mêmes les plus abstraits, les sophismes de la métaphysique la plus infatuée sont des façons de sentir générales et se retrouvent chez tous les êtres de même organisme assiégés par les mêmes images. Dans cet excès d’humiliation, une magnifique douceur nous apaise, nous invite à accepter tous nos esclavages et la mort: c’est si l’on veut bien comprendre-et non pas seulement dire du bout des lèvres, mais se représenter d’une façon sensible-que nous sommes la continuité de nos parents. »
De là une critique très sévère des intellectuels raisonnant in abstracto, incapables de saisir son appartenance à un collectif qui relègue au second plan les individus :
« Ces gens-là sont capables d’atteindre à la première étape de la culture: ils savent qu’un individu d’abord doit se connaître et prendre possessions, pour s’en servir, de son Moi. Mais ils ne poussent pas l’analyse jusqu’à distinguer comment le Moi, soumis à l’analyse, s’anéantit pour ne laisser que la collectivité qui l’a produit. »
Il proposa d’ailleurs, à la manière des Encyclopédistes du XVIIIe siècle, une définition polémique d’un rôle social, celui de l’intellectuel :
Intellectuel: individu qui se persuade que la société doit se fonder sur la logique et qui méconnaît qu’elle repose en fait sur des nécessités antérieures et peut-être étrangères à la raison individuelle. »
La raison n’a ainsi que peu de place devant le poids des atavismes :
« L’intelligence, quelle petite chose à la surface de nous-mêmes ! »
La conséquence finale de ce déterminisme est volontariste, et politique, c’est bien entendu la défense des intérêts du groupe auquel on appartient, et dont tous les membres dignes de ce nom :
« Un nationaliste, c’est un Français qui a pris conscience de sa formation. Nationalisme est acceptation d’un déterminisme. »
« Avec quel enthousiasme, comme on chante La Marseillaise, non pour les paroles certes, mais pour la masse d’émotions qu’elle soulève dans notre subconscient, je détaillais sans me lasser le terrible psaume nationaliste ! « Doublons et redoublons, disais-je , Dreyfus, Panama, Dreyfus! Nous avons combattu deux fois. Nous avons lancé la francisque à deux tranchants. « Oui, comme nos pères de la légende, pour s’entrainer, entonnaient le bardit « Pharamond, Pharamond » je répandais la double complainte: « Dreyfus et Panama » ».
Dans ce dense extrait Barrès présente à la fois ses espoirs passés, les causes qu’il a défendues, auxquelles il faut ajouter celle du général Boulanger, dont il fut un fervent partisan. Député à la Chambre en 1889 et siégeant dans le groupe des boulangistes, Barrès connut plus tard le scandale de Panama et l’affaire Dreyfus, qui toutes contribuèrent à légitimer son combat pour la défense des intérêts français, abandonnés par des gouvernants corrompus. Le combat pour la France fut celui de Barrès, pour lequel d’ailleurs il n’existait pas d’ethnie française :
« Disons-le une fois pour toutes: il est inexact de de parler au sens strict d’une race française. Nous ne sommes point une race, mais une nation; elle continue chaque jour à se faire sous peine de nous diminuer; de nous anéantir, nous, individus qu’elle encastre, nous devons la protéger. »
Bien que parlementaire, Barrès travailla mieux à ses objectifs par la littérature française que par le militantisme à visée électorale. Il le reconnut lui-même :
« (…) en interprétant les aventures de l’énergie nationale dans ces dernières années, j’ai mieux servi l’esprit français que par les trois cents réunions où j’ai dénoncé les parlementaires. »
L’affaire Dreyfus fut pour lui l’occasion de morigéner Jean Jaurès, qui, selon lui, au nom de la défense des droits de l’Homme, mettait en danger l’intérêt suprême de la patrie :
« (…) cette même audace révolutionnaire que M. Jaurès déploie maintenant au détriment de la patrie! Oui, au détriment de la patrie, puisqu’il tâche à tout détruire avec le seul bénéfice de réhabiliter un condamné, et ajoutons-le, au détriment du parti socialiste, puisque ce parti ne pourrait triompher que par une propagande toute différente de l’antimilitarisme, c’est à dire en faisant comprendre que les points principaux de son programme sont compatibles avec les nécessités d’un grand État dans l’Europe présente; »
Cependant, il reconnut qu’il pouvait existait chez certains dreyfusards autre chose que de l’inconscience :
« Je le sais bien qu’il faudrait incorporer dreyfusisme et antidreyfusisme dans un type supérieur; qu’il faudrait sauver ce qu’il y a du chevaleresque français chez le dreyfusien de bonne foi; qu’il faudrait systématiser cette double tendance, et puis coordonner, s’il est possible, ces éléments d’abord contradictoires dans un idéal commun. »
Barrès répondit à ceux qui disaient défendre Dreyfus par philosémitisme :
« Il ne faut point se plaindre du mouvement antisémite dans l’instant où l’on constate la puissance énorme de la nationalité juive qui menace de « chambardement » l’Etat français. »
La lutte intellectuelle et morale que menait Barrès fut aussi un combat contre l’universalisme, accusé de brader les intérêts nationaux au profit de raisonnements abstraits, et donc déphasés d’avec le monde réel. Il s’inscrit en opposition limpide contre Emmanuel Kant :
« Je dois toujours agir de telle sorte que je puisse vouloir que mon action serve de règle universelle. » Nullement, messieurs, laissez ces grands mots de toujours et d’universelle et puisque vous êtes Français, préoccupez-vous d’agir selon l’intérêt français à cette date. »
L’harmonie que Barrès juge nécessaire au salut de la patrie exige l’abandon assumé d’illusions cosmopolites, de raisonnements selon lesquels une communauté ne serait qu’une addition d’individus, déliés d’un passé encombrant :
« on ne saurait concevoir une idée plus fausse que celle d’une humanité plane, si j’ose dire, où il n’y aurait ni subordination, ni liens réciproques, ni chaîne des morts aux vivants, ni déférence, ni respect. »
Contre Zola, le « Vénitien », comme il le décrivait, qu’il affirmait être incapable d’intégrer l’esprit national de la France en raison de son origine étrangère, il écrira : « il s’entêtera et prolongera, comme un tonnerre vengeur sur la France, le bruit de cette casserole qu’il vient de s’attacher et qui fait le genre de tapage que depuis trente ans il confond avec les foudres de la gloire. »
Pour Barrès, un juif ne peut pas appartenir à la communauté nationale, ce qui d’ailleurs, ne l’empêchera pas de rendre hommage à ceux qui parmi eux se battront pour la France pendant la Grande Guerre :
« Les Juifs n’ont pas de patrie au sens où nous l’entendons. Pour nous, la patrie c’est le sol et les ancêtres, c’est la terre de nos morts. Pour eux, c’est l’endroit où ils trouvent leur plus grand intérêt. »
L’apôtre du nationalisme français, tel un médecin des souffrances de la nation, livra son diagnostic sur la France de son temps :
« Nous devons commencer, disais-je par comprendre les causes de notre affaiblissement. L’affaire Dreyfus n’est que le signal tragique d’un état général. Une écorchure qui ne se guérit pas amène le médecin à supposer le diabète. Sous l’accident, cherchons l’état profond. Notre mal profond, c’est d’être divisés, troublés par mille volontés particulières, par mille imaginations individuelles. Nous sommes émiettés, nous n’avons pas une connaissance commune de notre but, de nos ressources, de notre centre. »
Barrès est indissociable de son amour de l’ordre, condition nécessaire de l’harmonie :
« Heureuses ces nations où tous les mouvements sont liés, où les efforts s’accordent, comme si un plan avait été combiné par un cerveau ! »
Harmonie qui elle-même ne serait possible que par la renaissance d’une certaine « conscience nationale », elle-même indissociable de la réappropriation de la psychologie profonde du pays :
« Pour faire accepter cette vue raisonnable, réaliste, de la Patrie, il faut développer des façons de sentir qui existent naturellement dans le pays. »
Cet impératif est d’autant plus urgent à raviver que l’état de la France exige une solution rapide :
« Ne craignons pas de le répéter: la France est dissociée et décérébrée. »
Certes, ce n’est pas par la restauration monarchique qu’adviendra cette palingénésie communautaire : c’est bien ce qu’il écrivit à Maurras, par pragmatisme : la disparition de l’ancienne aristocratie, la nécessité de rallier le corps électoral à une solution qui saurait dégager une majorité solide, la division des derniers monarchistes rendrait illusoire la solution capétienne.
Le peuple de France doit réagir face à la décadence qui l’accable, parce qu’il se trouve lui-même en butte à l’hostilité de ses élites :
« Ces populations qui gardent le sang de la nation ne comprennent pas, n’interprètent pas de la même façon qu’une certaine minorité intellectuelle la civilisation française. »
Les élites de la nation sont responsables de l’aggravation de la situation, et de tous ses symptômes :
« Le décroissement de notre natalité, l’épuisement de notre énergie depuis cent ans que nos compatriotes les plus actifs se sont détruits dans les guerres et les révolutions, ont amené l’envahissement de notre territoire et de notre sang par des éléments étrangers qui travaillent à nous soumettre. »
Il nous faut rappeler que Barrès, pour tenter de freiner, ou mieux, de conjurer la faillite nationale menaçante, tenta de reprendre à son compte la cause d’un certain socialisme, en perte de vitesse face à un socialisme parlementaire ou révolutionnaire en pleine marxisation.
Son combat social fut cependant indissociable du combat national :
« Déserter la cause des déshérités serait déserter la cause de la nation elle-même. »
L’historien Zeev Sternhell décrivit ainsi les idées de ces gens qui se disaient « socialistes-nationaux », comme l’auteur des Déracinés. Pour ces militants, « la question sociale comporte trois volets : d’abord, la défense du travailleur français contre l’étranger, ensuite, la défense du travail contre l’exploitation capitaliste, et enfin, l’essentiel, l’intégration du monde ouvrier dans la collectivité nationale. »
L’étranger, perçu comme un agent désintégrateur et un outil du grand patronat contre l’ouvrier français, n’est pas le bienvenu :
« (…) en France le Français doit marcher au premier rang, l’étranger au second »
Barrès, dans la lignée d’un socialisme plus hexagonal que germanique, vitupéra contre le marxisme :
« Un principe essentiel selon lequel doit être conçue la nouvelle politique française, c’est de protéger tous les nationaux contre cet envahissement, et c’est aussi qu’il faut se garder contre ce socialisme trop cosmopolite ou plutôt trop allemand qui énerverait la défense de la patrie. »
La question sociale ne saurait d’ailleurs être séparée du « problème juif » :
« La question juive est liée à la question nationale. Assimilés aux Français d’origine par la Révolution, les Juifs ont conservé leurs caractères distinctifs et, de persécutés qu’ils étaient autrefois, ils sont devenus dominateurs. Nous sommes partisans de la plus complète liberté de conscience; en outre nous considérerions comme un grave danger de laisser aux juifs le bénéfice d’invoquer et par là de paraître défendre les principes de liberté civile promulguées par la Révolution. Mais ils violent ces principes par une action isolée qui leur est propre, par des mœurs d’accaparement, de spéculation, de cosmopolitisme. »
Alors candidat pour les élections législatives de 1898, Barrès brandit plusieurs slogans, tous révélateurs de son programme :
« Nous sommes partisan déterminé des parties principales de l’œuvre protectionniste. » et « Le nationalisme est un protectionnisme. C’est le souci des grands intérêts de la patrie. »
Dans quel but ? Protéger le travailleur de la concurrence étrangère.
« Contre le produit étranger. »
Parce qu’il peut se substituer au produit national, produit par des travailleurs nationaux.
« Contre la féodalité financière internationale »
Laquelle, parce qu’elle compte de nombreux juifs, est ennemie de la société française.
« Contre le naturalisé »
Parce qu’il est étranger au corps national. Enfin, il affirme que le socialisme n’est réalisable que dans la limite des frontières nationales :
« En dépit de Marx, la force des choses ne détruit pas les frontières. »
Aux internationalistes pressés de voir disparaître leurs nations, il répond :
« Conformément à vous principes, vous êtes obligés d’admettre, même si elle vous déplaît, la notion de patrie, car elle se précise, se fortifie chaque jour, et l’évolution se fait le long des siècles vers le nationalisme. »
A Jaurès, qui ne semble pas comprendre l’enjeu véritable : »Le nationalisme, vous dis-je, est la loi qui domine l’organisation des peuples modernes. »
Mieux, récuser le nationalisme, c’est aller contre le sens de l’Histoire, car :
« L’évolution se fait le long des siècles vers le nationalisme. » Le socialisme lui-même se devant de sauver la nation de tous les dangers, d’où qu’ils viennent :
« Le danger pour la France, ce sont les violences qui déracinent sans rien fixer et l’internationalisme qui dénature: voilà à quoi s’oppose le nationalisme. »
Et puisque « Le nationalisme ordonne de juger tout par rapport à la France », il est nécessaire d’articuler la lutte sociale avec celle de la nation :
« Qu’est-ce que tout cela, sinon la lutte de la terre et de la race contre la féodalité financière ? »
Il semble bien que l’ennemi principal, désigné par Barrès soit la finance apatride :
« Ce qui fait de cette puissance financière la grande menace pour les États modernes, c’est qu’elle s’exerce sur le revenu de tous les capitaux, sur le prix de tous les objets, sur le taux de tous les salaires, c’est-à-dire sur ce qui compose dans le menu la trame serrée et profonde des millions d’existences humaines dont l’ensemble forme l’humanité. »
La société idéale imaginée par le député Barrès mettrait également en œuvre l’abolition du salariat, et donc, par voie de conséquence du patronat.
Les morts s’honorent. La terre aussi. Ces deux éléments déterminent nos vies, car « Notre terre nous donne une discipline et nous sommes les prolongements de nos morts. Voilà sur quelles réalités nous devons-nous fonder. »
A une époque où l’idée de revanche anime une grande partie de l’opinion française, Barrès explique sa conception de la patrie :
« Ma définition de l’idée de patrie, c’est à savoir la Terre et les Morts, par quelque méditation sur les provinces d’Alsace et de Lorraine ».
S’agit-il de pleurer des cadavres et des champs cultivés, lorsqu’il faut honorer ses morts ? Absolument pas :
« Ce que nous pleurons, ce n’est pas un corps rendu à la terre c’est une affection qui nous enveloppait, une conscience qui nous dirigeait. Ce qui était lui, c’étaient ses conseils, ses bienfaits, ses exemples: tout cela est vivant dans notre souvenir. Que sa pensée nous soit toujours présente dans les luttes de la vie. Il y a des heures où l’ombre est bien épaisse: que ferait-il à notre place? que nous dirait-il de faire? C’est là qu’est le devoir; par cela que nous pensons à lui, sa force bienfaisante s’étend sur nous comme pendant sa vie: c’est ainsi que les morts tendent les mains aux vivants. »
La terre et les morts ne font qu’un :
« Le terroir nous parle et collabore à notre conscience nationale, aussi bien que les morts. C’est même lui qui donne à leur action sa pleine efficacité. Les ancêtres ne nous transmettent intégralement l’héritage accumulé de leurs âmes que par la permanence de l’action terrienne. »
Une dernière idée doit être retenue, conséquence des méditations barrésiennes sur la Terre et les Morts. L’enracinement, résultat de l’acceptation du déterminisme, a pour finalité, au-delà du sentiment d’appartenance qu’il offre à l’individu, de servir sa patrie. Une patrie qui ne peut compter sur lui que s’il a lui-même su se « raciner » :
« (…) la patrie est plus forte dans l’âme d’un enraciné que dans celle d’un déraciné ».
Vincent Téma,
le 04/12/23 (vincentdetema@gmail.com)
