D’Annunzio le magnifique

12 septembre 1919. Onze heures quarante-cinq. Une colonne de deux mille hommes entre triomphalement dans la ville de Fiume, port dalmate occupé par une force interalliée. Les négociations entourant les traités de paix vont certainement refuser l’ancien port hongrois à l’Italie et le donner à la nouvelle Yougoslavie, décision que tous ces hommes — grenadiers, aviateurs, arditi et autres survivants italiens des tranchées, arborant tous chemises noires et poignards — ne se résignent pas à accepter. Audessus d’eux, sur un drapeau rouge, lové sur lui-même, le Serpent Ourobouros transforme l’expression latine de Saint-Paul1 et siffle : « Si spiritus pro nobis, quis contra nos ? » (Si l’esprit est avec nous, qui est contre nous ?) Les hommes, électrisés, répondent en choeur par un chant de combat : « Giovinezza, Giovinezza, Primavera di bellezza / per la vita, nell’asprezza il tuo canto squilla e va ! » (Jeunesse, jeunesse, Printemps de beauté / dans la vie âpre ton chant résonne et s’en va). Débute alors une aventure-épopée unique en son genre, cinq cents jours d’une contre-société expérimentale 2 dont le principe fondamental proclamé est la musique, cinq cents jours d’une cité de vie où se conjuguent fête et discipline, cinq cents jours d’une pratique collective et archéofuturiste de la révolte. A la tête de cette colonne et de la future Régence italienne du Carnaro qui va gouverner la ville, un homme d’un mètre soixante-quatre, chauve, peau couverte de décorations, monoclé et mains gantées, il approche de la soixantaine, il est poète célèbre, soldat de la Grande Guerre, « barde du peuple » et bientôt… Roi. Il s’appelle Gabriele D’Annunzio. A travers le récit des épisodes de son existence, baroque et agitée, c’est le mystère de cet homme étrange, « tout poivre et nerfs », aux allures de Napoléon un peu sauvage, que le livre de Maurizio Serra se propose de pénétrer. D’un côté, la tâche pourrait sembler aisée tant le personnage n’a jamais rien caché et orgueilleux omnivore, a voulu monter sur toutes les scènes et conquérir tous les théâtres sans jamais dissimuler ses intentions. Mais cette profusion de pièces à conviction ne garantie pas une preuve absolue : l’homme se dérobe toujours quelque peu car, selon le mot de Suarès qui a donné le titre au livre de Maurizio Serra : « D’Annunzio est le plus magnifique de ses personnages. » Alors que s’est-il passé sous ce crâne dégarni qu’il surnommait sa « clarté frontale » pour qu’âgé de cinquante six ans son corps se lance dans une folle équipée qui le fera Roi ? L’auteur le confesse : aucune biographie de parviendra à épuiser le « sujet D’Annunzio ». Alors il faut néanmoins rassembler, détailler, examiner toutes les actions, les discours et les gestes, les collisions sensuelles et les étincelles spirituelles, se baigner dans les œuvres, dresser les décors et les personnages qui entourent le poète — la haute société, les femmes virevoltantes, les soldats fascinés, les dramaturgies de volupté et de mort. Et trois grands flambeaux se dressent alors comme des aiguillons brûlants dans cette existence qui ne veut jamais se reposer : la poésie, les femmes, la guerre.

Aujourd’hui, pour un jeune européen de l’ouest, épargné par la guerre, bercé de discours bêtifiants et béatement humanistes sur la violence et à qui sont proposés, comme héros et hérauts du moment, des saltimbanques millionnaires, des aventuriers de plateaux télé ou des startupers transhumanistes, un caractère rebelle et aventureux comme celui de D’Annunzio suscite des interrogations et semble appartenir à un type d’homme révolu ou, en tous cas, anachronique par rapport aux modèles promus et normalisés par notre époque. Comme si le goût du danger et l’instinct belliqueux chez l’homme pouvaient être éradiqués à coup de longues périodes de paix, d’environnement « climatisé » et de slogans publicitaires. On ne peut supprimer cette part d’ombre. Dans une optique d’harmonisation individuelle et collective, on peut, tout au plus, négocier avec elle et lui laisser la place qui lui revient car le désordre qu’elle porte est aussi source de vie. L’ombre refoulée par une rationalité aseptique fait généralement retour d’une manière extrême, cruelle et avec une intensité décuplée. Ceux qui éconduisent le discours dit progressiste, taxant tout comportement non conforme à son évangile désincarné de modèle dépassé, ont bien saisi le message de Zarathoustra : « Je vous le dis : il faut porter encore en soi un chaos, pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » C’est le chaos de ce type d’homme différencié que D’Annunzio le Magnifique veut nous faire percevoir. Le poète confie qu’il « adore la guerre » et il ajoute : « Ce fut pour moi un second étincellement de jeunesse. Ne fût le sang d’autrui qui coule, je serai tenté de considérer avec effroi la fin de la guerre ». Ce qui ressort dans les parties du livre consacrées aux expériences guerrières de notre personnage est parfaitement résumé dans leurs titres respectifs : Le Conquérant et Le Commandant. Désir de conquête donc. Conquête du verbe, des femmes, du monde. Désir de conduire également, d’assumer sa nature de « condotierre de la Renaissance », d’être héraut, d’être Roi. Conserver l’énergie pure et première de la jeunesse qui ne veut pas se résigner au statu quo. Être fidèle à sa nature d’ « homme-animal », prendre la guerre comme expérience intérieure, pour reprendre le titre d’un essai d’un autre écrivain-soldat, allemand cette fois, ayant combattu en 14-18. Ainsi, en dépit de leurs réticences, D’Annunzio, alors âgé de 52 ans en 1915, parviendra, à force d’insistance, à convaincre les autorités militaires italiennes de l’enrôler.
Certes, il n’a pas connu les tranchées, mais aucun doute n’est permis quant au caractère risqué des opérations qu’il a menées, aussi bien dans l’infanterie, la marine ou en tant qu’aviateur, ni sur une certaine bravoure dont il a fait preuve. Selon Maurizio Serra, il serait malhonnête d’en faire un dilettante qui aurait joué à la guerre et se serait préservé de tout danger dans un conflit qui fut d’une violence extrême. Il perd d’ailleurs son œil droit dans un accident dont les circonstances ne sont pas vraiment élucidées3. Cette blessure obligera ce désormais « borgne voyant » à, une fois encore, devoir insister auprès des autorités pour reprendre du service. De cette période de guerre naîtra son dernier chef-d’œuvre, Nocturne, confession dans laquelle il se dévoile plus intimement. L’ouvrage, qui ne sortira qu’en 1921, est décrit par Serra comme « un des documents les plus humains, fraternels, mystiques inspirés par le conflit », « un journal de l’âme par la guerre, plutôt qu’un journal de guerre ».
C’est durant cette même guerre que les italiens créèrent des unités de choc sur le modèle des Stosstruppen allemandes : les arditi. Nombre de ces « hardis » qu’il recruta lui-même l’accompagneront, plus tard, lors de l’épopée de Fiume. Baroudeurs, soldats aguerris, garçons dévoyés et aussi bien aristocrates et intellectuels composeront ces troupes. Cette biographie mentionne également un autre personnage tout aussi fascinant que notre poète-guerrier italien, un japonais membre des arditi et intime de D’Annunzio : le poète japonais Harukichi Shimoi, surnommé plus tard le « samouraï de Fiume » et avec lequel D’Annunzio projettera un raid aérien Rome-Tokyo. A propos de Fiume, nous apprenons que ce coup de force ne fut pas impulsif et improvisé mais préparé de manière pragmatique. Nous pouvons également déceler dans les démarches effectuées auprès de Mussolini en vue d’obtenir son appui, la méfiance de D’Annunzio vis-à-vis du Duce (la suite des événements montrera qu’elle était justifiée). Quant à l’aventure elle-même, l’occupation de la ville qui dura 16 mois, elle est principalement envisagée d’un point de vue politique4 et elle fait pièce aux exégèses visant à réduire cette expérimentation, riche et complexe, à un proto-fascisme de carnaval. A l’appui de cette thèse, plus nuancée et moins idéologisée, viennent quelques faits : Lénine et Gramsci s’intéresseront de près à cette expérience politique avant-gardiste ; la Régence du Carnaro fut le premier État à reconnaître l’URSS ; D’Annunzio reconnaîtra le parti indépendantiste irlandais du Sinn Féin ; plus globalement Fiume portera un message international de droit à l’auto-détermination des peuples ; enfin, à la différence de certaines options fascistes ultérieures, la sédition fiumaine ne s’attira pas la sympathie des Alliés ni des autorités italiennes. Avec le même souci de restituer les événements dans toute leur diversité et leur complexité, l’auteur passe également en revue les différents acteurs de cette entreprise unique. Dans cette galerie de personnages et de tendances dont l’union reposait, pour grande part, sur la personnalité même du Comandante D’Annunzio, on trouvait ainsi des nationalistes ou patriotes, des expansionnistes ou impérialistes, des internationalistes dont le syndicaliste révolutionnaire Alceste De Ambris, bras droit de D’Annunzio qui s’opposera plus tard au fascisme au sein des Arditi del Popolo5. Mais se rencontraient aussi des futuristes et des personnages singuliers tels l’as de l’aviation Guido Keller ou le poète et musicien Léon Kochnitzky. Cet exemple d’imagination au pouvoir s’achèvera en décembre 1920, après une longue période de siège et avec l’intervention de l’armée régulière, dans un épisode portant un nom qui parle de lui-même : « Le Noël de sang ».
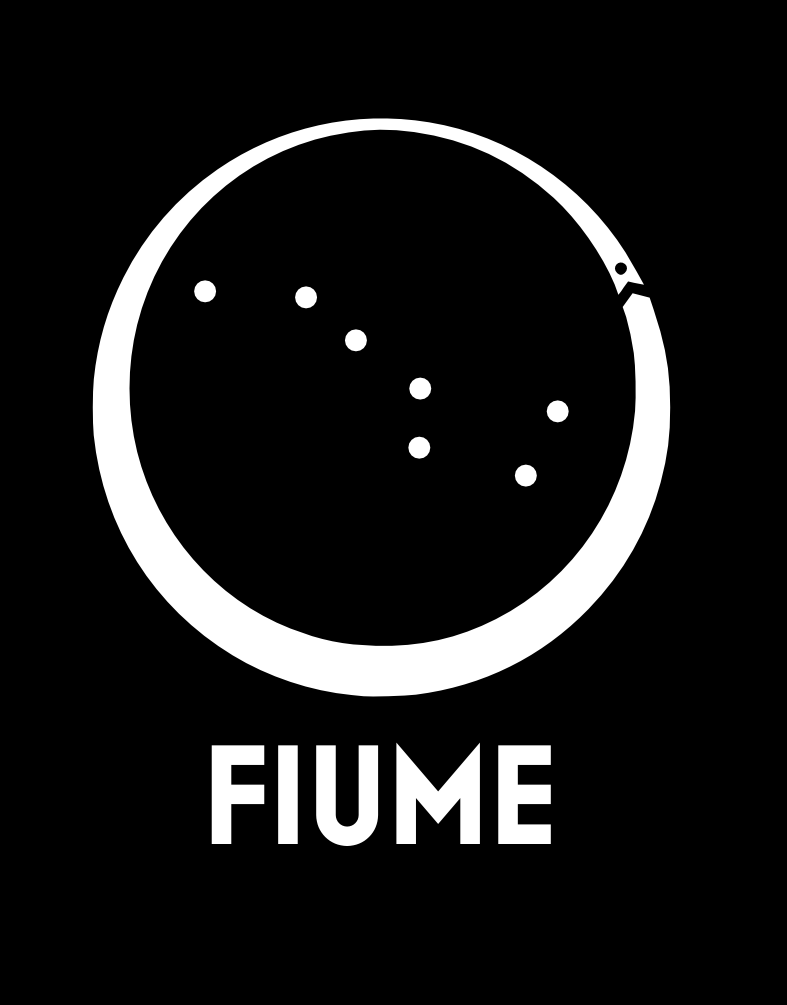
C’est encore le langage de la guerre et du combat qui prévaut lorsque D’Annunzio parle de la femme. Pour lui, elle est « l’ennemie nécessaire ». Nous verrons plus loin ce que recouvre plus exactement cette expression ambiguë. Toutefois, décrire D’Annunzio comme un Casanova de bazar ne correspondrait pas à la réalité du personnage. Ce qui ressort du livre de Serra, c’est indéniablement une sensualité exacerbée mais le personnage n’est pas, à proprement dit, un obsédé sexuel. Serra parle plutôt d’ « obsédé sensuel » car c’est bien, avant tout, de l’âme des femmes convoitées dont il veut s’emparer. Le magnétisme qu’il exerce auprès d’elles relève certainement de ce « priapisme physique et cérébral » qui émane de sa personne. Fanatiser la femme comme fanatiser la foule — la foule étant femme — semble être la finalité de l’énergie déployée pour ses conquêtes. Sa période romaine fût le théâtre de relations multiples dans lesquelles cet « homme-animal » considérait les femmes comme des proies à posséder intégralement. Cette période marqua également le début de sa carrière d’ « endetté permanent » qui ne finira qu’à sa mort, ses conquêtes et liaisons ne faisant pas l’économie d’une profusion de cadeaux et de dépenses diverses. Quelques éléments témoignent de ce rapport aux femmes qui apparaît aujourd’hui d’autant plus singulier qu’il contrevient aux nouveaux crédos que notre époque tente d’imposer. Il épouse, par exemple, à vingt ans, en 1883, une « petite duchesse inoffensive » dont il ne divorcera jamais pour ne pas être obligé d’épouser les autres compagnes qui jalonneront immanquablement et régulièrement toute son existence. Dans ce rapport aux femmes, nous retrouvons un élément typique de sa personnalité, un mélange de calcul, de contrôle de soi et d’exaltation. Belliciste et esthète à la sensibilité élevée, il est par ailleurs extrêmement attentif aux détails physiques, caractéristique qui nourrira bien entendu sa littérature. Sur le terrain des femmes, c’est donc encore sa prédilection pour la conquête et la possession qui s’exprime. La plus rétive à cette disposition toute totalitaire et à ce machisme vampirique fut Eleonora Duse, une tragédienne surnommé la Divina qui s’emploiera à ne pas abandonner ses velléités d’indépendance ainsi que son goût pour les femmes. La résistance de cette primadonna de laquelle « émane un halo sexuellement trouble » et qu’il rencontra en 1895, alors qu’elle avait entamé la trentaine, laissera d’ailleurs notre héros quelque peu dépité. Elle fut toutefois une vraie muse et nourrira la production de D’Annunzio jusqu’en 1905 quand, mû par sa logique vampirique de possession et de rejet (« ce qui a été n’est plus »), il se tournera alors vers une nouvelle proie, Alessandra di Rudini Carlotti del Garda, qu’il surnommera Niké en hommage à la divinité de la victoire. Sur l’importance de la Divina, nous pouvons lire la chose suivante : « On a calculé qu’en six ou sept ans à peine, entre 1898 et 1905, D’Annunzio a écrit vingt mille vers sous forme de poèmes et douze mille vers pour ses drames (…). Cette productivité phénoménale, même pour lui, n’a pas été toujours inspirée par la Duse, mais aurait atteint difficilement ce record sans elle. » Cette aventure passionnée irriguera également son grand roman intitulé Le Feu dont le personnage principal sera Eleonora.
Deux autres figures féminines émanent de cette myriade de rencontres et de liaisons, du moins pour ce qu’elles révèlent de la psychologie de D’Annunzio, c’est-à-dire de cette oscillation entre mépris utilitariste et exaltation démesurée : une première, antérieure à la Duse, Barbarella Leoni en 1887 et une autre, postérieure, Nathalie-Donatella en 1908. La rencontre avec la première fut un véritable choc pour Gabriele. Cette « lionne barbare », cette « espèce de sauvageonne », cette « pulpeuse fille du peuple » trouvera avec lui cette volupté de laquelle un traumatisme subi dans le lit nuptial — un mariage malheureux avec comme cadeau de noces une maladie vénérienne — l’avait séparée. La secousse sismique subie par Gabriele eut des répercussions pendant cinq ans et s’estompa après avoir provoqué une avalanche de milliers de lettres, de télégrammes et de billets doux. Serra ajoute : « Il est amoureux de l’amour, pas de cette créature de rêve, qu’il veut dévorer jusqu’au bout, pour assouvir la faim qu’elle lui inspire. » Concernant Nathalie-Donatella, Maurizio Serra donne également les raisons de l’intérêt qu’elle suscite chez D’Annunzio et en quoi cette liaison révèle un ressort psychologique du Magnifique : « Elle l’intrigue par son charme slave, son allure de panthère, son insatiable lubricité, bref tout le paquet. Sans compter le mystère de ses origines : est-elle fille d’un petit marchand juif, ou d’un officier de la garde impériale ? Cette nouvelle incarnation de la Femme fatale aux multiples attraits (…) n’ajoutera pas grand-chose au sérail d’annunzien. Elle est pour lui le prototype de ces « pauvres folles » (Roland), ou cinglées de luxe (…). A une ou deux exceptions près, ces vestales n’ont rien signifié pour lui, rien ajouté à son œuvre, rien perçu de l’exigence qui l’habitait. Elles n’auront finalement représenté qu’un divertissement ou un décor qui servait (…) à meubler ses baisses d’inspiration et sa virilité déclinante. » Nous saisissons donc mieux au travers de ces exemples ce que recouvre l’expression « l’ennemie nécessaire » par laquelle nous avions introduit cette partie consacrée aux femmes.
D’Annunzio, ce sont donc des grandes lignes de force qui s’activent. Se détachent d’abord ce goût pour l’aventure et un sens aigu de la dramaturgie, dispositions qui verseront indéniablement dans l’emphase mais qui se contenteront de flirter incidemment avec le cliché sans jamais toutefois y succomber. Prend forme également au fil de la lecture de D’Annunzio le Magnifique, une silhouette nietzschéenne qui refuse la vie tiède et bourgeoise et prend le parti de la vie, mobilisant pour cela une énergie toute dionysiaque. Ce qui frappe c’est cette volonté de ne pas s’endormir, ne pas céder à la satisfaction, au confort. Lorsque le guette le dannunzisme, lorsqu’il atteint une sorte de maîtrise à la fois de son art et de son personnage, il cherche dans la vie même le danger, le feu régénérateur qui lui évitera d’être simplement lui-même, achevé dans un contentement de soi de ruminant. C’est ce caractère faustien qui le poussera à 56 ans à se lancer dans l’aventure de Fiume. Pour lui, s’endormir c’est se rendre vulnérable. Il est animé d’un vitalisme nourri par ce proverbe local qu’il n’oubliera jamais : « Qui se fait brebis, trouve le loup qui le dévore. » Pour ce faire, il doit créer avec frénésie, créer sa propre vie et la créer la plus extraordinaire qui soit dans un royaume à son image. Si l’on devait résumer ce qu’il est, on pourrait dire : D’Annunzio c’est Fiume, Fiume c’est D’Annunzio. Et Fiume, c’est un radical et nietzschéen oui à la vie. Et d’ailleurs, pour se définir lui-même, on l’entendrait bien dire, amusé : D’Annunzio c’est moi !

D’Annunzio, ce sont aussi les opposés qui s’accordent : préciosité et violence, la volupté et le raffinement avec la sauvagerie la plus primitive6 ; l’ascétisme et le calcul avec la démesure la plus fantasque (il avait pour projet fou de faire construire un amphithéâtre gigantesque en plein air) ; enfin l’Antiquité comme bain spirituel avec la modernité la plus excessive (il était un amateur de vitesse, de technique, cela l’amènera d’ailleurs à s’intéresser au cinéma naissant). En résumé, il est « impulsif à la surface » et « calculateur dans le fond », la chair contre l’esprit. Laisser agir ses instincts et ses pulsions tout en contrôlant son destin, tel semble avoir été l’enjeu. L’amour sous la volonté. Du livre de Maurizio Serra, se dégage enfin la figure d’un individu absolu désireux de se mettre au service d’un ordre supérieur. Il veut avoir un rôle à jouer et incarner, dans cette modernité asphyxiante qui tue dans l’œuf les légendes et les mythes, un type d’homme intemporel.
L’enjeu était de taille et c’est avec un D’Annunzio mis à l’écart (par Mussolini) et quelque peu épuisé que se conclue cette biographie. Cloîtré dans son Vittoriale degli italiani, supplanté dans le monde par de nouvelles forces et de nouvelles figures, on l’imagine mal cependant en train de savourer une sorte de devoir accompli et de se dire que, voilà, il a joué son rôle et il a fait de son mieux. Ceux pour lesquels il est encore aujourd’hui une figure agissante se représentent plutôt le héraut au seuil de la mort dans une posture toute olympienne, en train de lancer par delà les générations un radical et tonitruant : « En avant, par delà les tombeaux ! »7.
E. Frankovich
Sauf mention contraire, les expressions entre guillemets sont tirées du livre de Maurizio Serra.
A lire : Maurizio Serra, D’Annunzio le Magnifique, Grasset, 14 février 2018.
Note
1. Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 31b-39) : « Si Deus pro nobis, quis contra nos » (Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?)
2. « contre-société expérimentale », l’expression est de Claudia Salaris dans son ouvrage A la fête de la révolution, Editions du Rocher, 2006.
3. Maurizio Serra fait cette remarque à propos de la perception de la réalité : « D’ailleurs ce qui est vrai pour d’Annunzio est ce qu’il sent, croit imagine comme tel. »
4. Dans la présentation des différents groupes présents sur place, Maurizio Serra distingue entre « fiumains, centrés sur l’agenda politique » et « fiumistes, plus sensibles aux aspects de caractère social, existentiel et intellectuel ». Ce versant plus intellectuel et artistique a été magnifiquement traité dans l’ouvrage A la fête de la révolution, Artistes et libertaires avec D’Annunzio à Fiume de Claudia Salaris.
5. C’est une organisation née de la scission des Arditi et qui optera pour la lutte contre les fascistes.
6. Cette fougue lui vient de la terre abruzzaise de ses origines, fonds dont il ne se séparera jamais. Ce loup des Abruzzes conservera cette dimension primitive et sauvage, forme de saine vulgarité provinciale qui ne fera pas de lui un dandy éthéré et caricatural assimilé à une bourgeoisie gangrenée par l’argent.
7. Cité dans Un Prince de l’Esprit, Raymonde Lefèvre, Nouvelles éditions latines, 1951.
